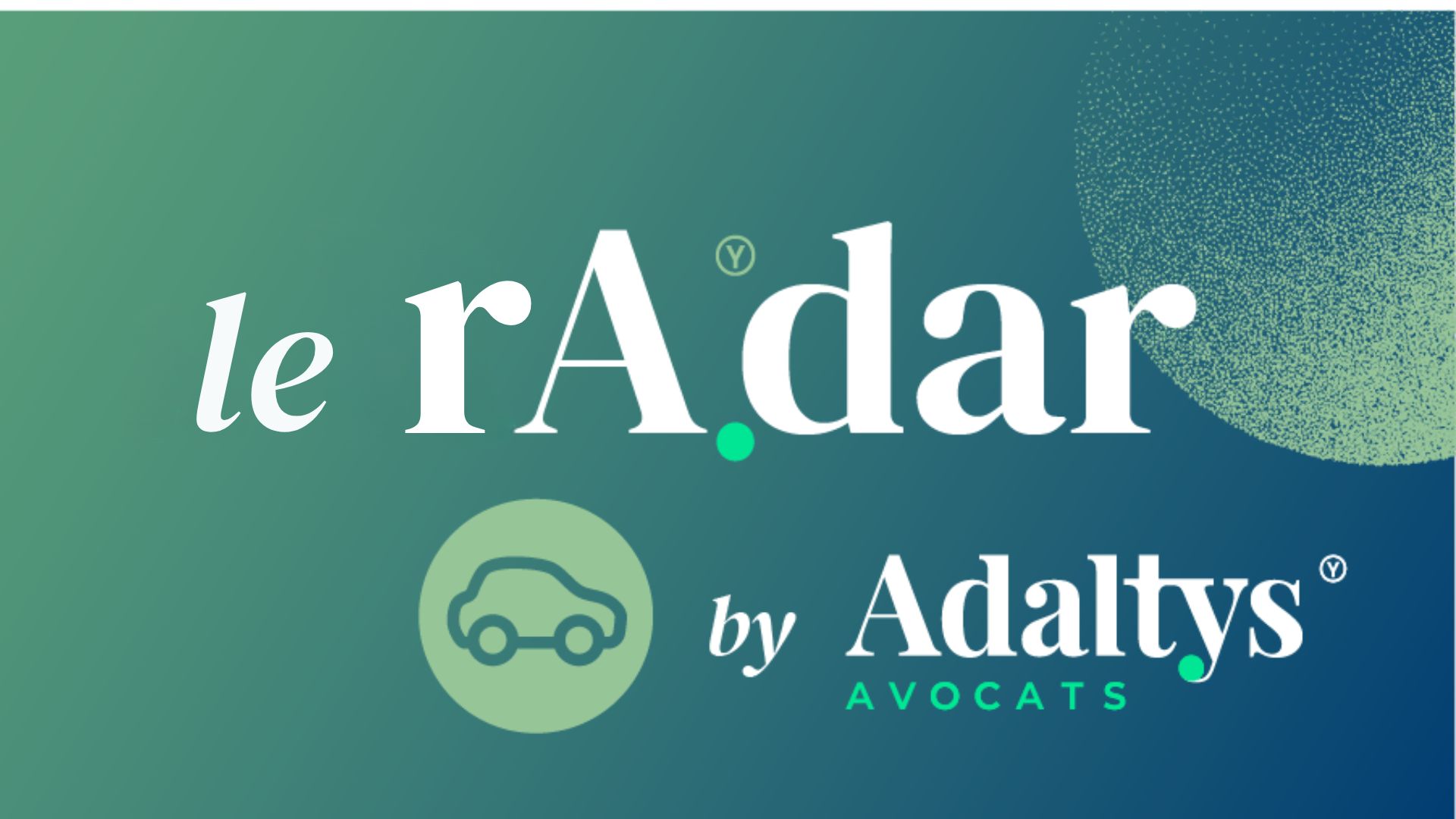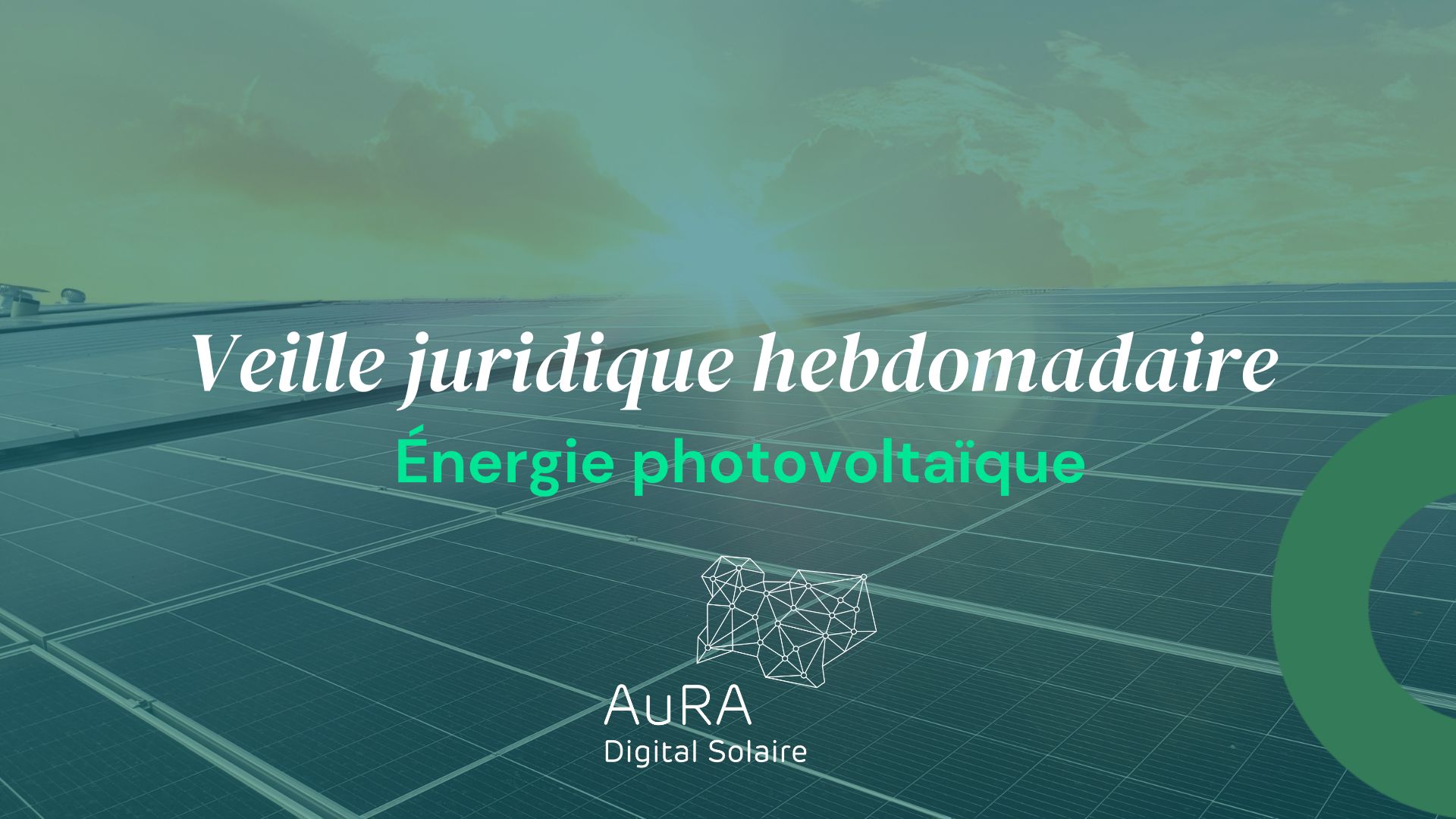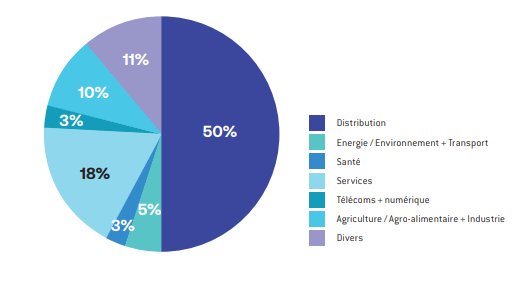Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 (dans sa version rectifiée du 23 août), qui est entré en vigueur ce 1er septembre 2025, opère une refonte des dispositions relatives à l’instruction conventionnelle et aux Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD), dans le but de promouvoir une approche encore plus contractuelle et collaborative du procès civil.
Il s’applique aux instances en cours au 1er septembre, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, applicables aux seules instances introduites à compter du 1er septembre.
I- Une approche plus collaborative du procès civil
Cette nouvelle approche a conduit à une réécriture de l’article 21 du Code de Procédure Civile (ci-après « CPC ») pour y introduire un principe directeur de coopération en ces termes :
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
L’article 3 du décret consacre ainsi un changement de paradigme procédural, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et l’instruction judiciaire en exception.
Il en résulte que les affaires doivent en principe être instruites conventionnellement entre les parties, et ce n’est qu’à défaut qu’elles seront instruites judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement feront l’objet d’un audiencement prioritaire.
Afin de mettre en œuvre cette nouvelle approche, la procédure participative qui permet aux parties d’organiser conventionnellement la mise en état de leur affaire est simplifiée. Une voie de mise en état conventionnelle simplifiée et moins formelle est par ailleurs instaurée.
- Simplification de la procédure participative aux fins de mise en état
Le régime de la procédure participative aux fins de mise en état[1] est assoupli : les actes d’instruction n’ont plus besoin d’être systématiquement contresignés par avocat, la convention interrompt le délai de péremption de l’instance[2] et, en appel, interrompt les délais de procédure impératifs. Enfin, la procédure participative ne dessaisit plus le juge, qui peut notamment statuer sur des exceptions de procédure ou prononcer des mesures provisoires[3].
- Introduction de l’instruction conventionnelle
Cette nouvelle procédure au formalisme allégé est instaurée par le Décret : elle ne requiert pas un acte contresigné par avocats, elle peut se matérialiser par de simples conclusions concordantes des avocats ou par une copie de la convention adressées au juge[4], la conclusion d’une telle convention ne nécessitant pas obligatoirement que les parties soient représentées par un avocat[5]. Cette souplesse vise à favoriser son usage, en particulier dans les dossiers où une mise en état lourde et détaillée ne se justifie pas.
L’intérêt d’une telle convention est double : d’une part, elle interrompt le délai de péremption de l’instance[6], d’autre part, elle offre aux parties une flexibilité accrue dans la définition de leur calendrier procédural. Le juge n’est pas totalement dessaisi pour autant : il conserve un rôle de supervision, pouvant intervenir pour régler les incidents, statuer sur les fins de non-recevoir ou encore ordonner des mesures provisoires[7]. Si toutefois la convention compromet les principes directeurs du procès, le droit à un procès équitable, ou bien si elle ne permet pas de mettre l’affaire en état, le juge, d’office ou à la demande, peut reprendre l’instruction judiciaire[8].
II- La place de l’amiable renforcée
- La généralisation de l’audience de règlement amiable (ARA)
L’article 17 du Décret a refondu entièrement le livre V du Code de Procédure Civile en y regroupant l’ensemble des règles relatives aux modes de résolution amiable des différends, tant conventionnels que judiciaires, à des fins de clarté et de lisibilité.
L’une des conséquences directes de cette recodification est la généralisation de l’audience de règlement amiable à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, à l’exception des juridictions prud’homales, alors que jusqu’ici l’ARA n’était applicable qu’à certaines procédures devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.
La convocation à une audience de règlement amiable peut être prononcée par le juge saisi de l’affaire ou par le juge chargé de l’instruction, à la demande de l’une des parties ou d’office[9].
La convocation à une ARA interrompt le délai de péremption de l’instance[10], et en appel, interrompt les délais impératifs[11].
- La généralisation de l’injonction de rencontrer un médiateur
Le Décret renforce le dispositif d’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur prononcé par le juge[12]. Le juge peut, à tout moment de l’instance, y compris en référé, ordonner cette rencontre, qui prend la forme d’une réunion d’information sur la médiation ou la conciliation.
L’une des nouveautés tient à la sanction introduite par le texte. Selon le nouvel article 1533-3 du CPC, le médiateur ou le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion, cette dernière pouvant alors être condamnée à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sauf à justifier son absence par un motif légitime. Le nouvel article 1533-1 du CPC précise à ce titre que le principe de confidentialité ne couvre pas l’information relative à la présence ou l’absence des parties à la réunion.
- La confidentialité des modes alternatifs de règlement des différends
Une autre innovation notable du Décret porte sur le périmètre du principe de confidentialité dans les modes de résolutions amiables.
Le nouvel article 1528-3 du CPC précise que, sauf accord contraire des parties, la règle de la confidentialité s’applique à tout ce qui est dit, écrit ou fait lors de l’audience de règlement amiable, ainsi qu’aux pièces « élaborées dans le cadre des processus amiables ».
Néanmoins, il est précisé au même article que les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
- Un allongement des délais en médiation et conciliation judiciaire
Le nouvel article 1534-4 du CPC rallonge les délais du processus de médiation judiciaire. La durée initiale de la conciliation ou de la médiation ne peut dorénavant excéder 5 mois (contre 4 auparavant), et un prolongement de 3 mois de la mission pourra être accordé à la demande du conciliateur ou du médiateur.
- Le recours à un technicien
L’un des objectifs du Décret est aussi de permettre le recours, par les parties, à un technicien au cours de l’instruction conventionnelle[13]. Pour ce faire, avant tout procès au fond ou une fois le juge saisi, les parties peuvent désigner d’un commun accord le technicien auxquelles elles souhaitent faire appel, et déterminer ses missions. Il convient de souligner à ce titre quatre nouveautés importantes :
- le rapport réalisé par le technicien aura la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée judiciairement (expertise judiciaire notamment), lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats[14] ;
- les parties disposeront d’un recours au juge en cas de difficulté relative à l’exécution de la convention[15] ;
- tout tiers intéressé pourra, avec l’accord des parties, être associé aux opérations menées par le technicien. Ledit tiers deviendra alors partie à la convention[16] ;
- le technicien pourra exercer à la fois une mission d’expertise et une mission de médiation.
- Homologation des accords amiables
Le Décret harmonise et clarifie également le régime d’homologation des accords issus des MARD au sein du Titre IV du Livre 5.
Selon l’article 1544 du CPC, il n’appartient au juge de n’exercer qu’un contrôle limité : il vérifie la licéité de l’objet de l’accord, et sa conformité à l’ordre public, et ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord. Cette approche permet de donner force exécutoire aux accords amiables dans des délais plus brefs, tout en préservant la liberté contractuelle des parties. L’homologation devient ainsi une étape simplifiée et sécurisée, consolidant la place centrale des MARD dans l’architecture du procès civil.
Conclusion :
Ce Décret opère une véritable mutation du procès civil, en plaçant l’amiable et l’instruction conventionnelle au cœur de la procédure. Il renforce la coopération entre juges et parties, tout en offrant des outils plus souples et efficaces pour accélérer la résolution des litiges. Reste désormais à observer comment ces nouvelles dispositions seront mises en œuvre concrètement dans la pratique.
Co-rédacteur : Samuel Grassin
[1] Art. 130 à 130-7 CPC
[2] Art. 130-3 1° CPC
[3] Art. 130-3 2° CPC
[4] Art. 129-2 CPC
[5] Circulaire du 19 juillet 2025, sur le décret portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends.
[6] Art. 129-3 1° CPC
[7] Art. 129-3 2° CPC
[8] Art. 129-2 CPC
[9] Art. 1532
[10] Art. 1532 CPC
[11] Art. 915-3 CPC
[12] Art. 1533 CPC
[13] Art. 128 CPC et 131 à 131-8 CPC
[14] Art. 131-8 CPC
[15] Art. 131-3 CPC
[16] Art. 131-6 CPC